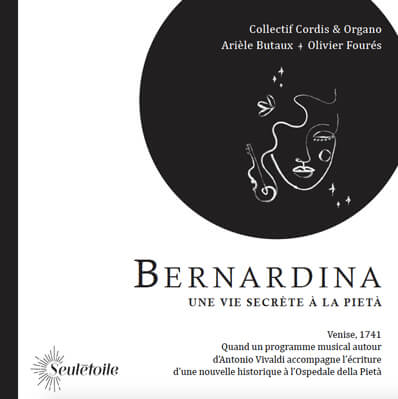BRILLON DE JOUY, The piano sonatas rediscovered, Nicolas Horvath, piano; label Grand piano ; 2 CD. Premier enregistrement mondial.
Christine de Pas, première biographe d’Anne-Louise Brillon de Jouy (1744-1824), rappelle dans « Madame Brillon en son temps », une des notices du livret, ce mot désolé d’Élisabeth Vigée Lebrun, ( faut- il dire le ou la peintre tant, significativement, la langue hésite sur le genre), qui peignit tant de portraits de belles dames, dont Marie-Antoinette :
« Les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées. »
Nostalgie certes d’une fidèle de l’Ancien Régime monarchique dont nous devons rappeler le nombre de salons où régnaient des femmes, souvent savantes, philosophes, politiques, qui furent des foyers intellectuels où se forgea une Révolution ingrate aux femmes : en effet, malgré le droit de divorce qu’elle leur accorda, avec des figures féminines héroïques et grandioses qui payèrent sur l’échafaud leur tribut révolutionnaire, la Révolution n’aura pas émancipé les femmes, les écartant même, grammaticalement, dénoncent —abusivement— les féministes, de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, en réalité terme neutre et générique qui signifie ‘être humain’, incluant donc tous les sexes, renommée aujourd’hui « Droits humains ». Plus sérieusement, plus grave que cette discutable querelle de langue inclusive, la Révolution dénie aux femmes le droit de vote.
Sans en être la reine, sans doute, Anne-Louise Brillon de Jouy (1744-1824) en fut l’une, régnant et rayonnant par son salon, l’un des rares où la musique était souveraine. De sa touche rapide et nerveuse, qui tient d’un Rubens baroque allégé par le rococo de Tiepolo, Fragonard en brosse un portrait : sur fond sombre, un frais visage aux joues et souriantes lèvres de rose, si prisées en son temps, de trois quarts, un ravissant minois aux yeux rieurs émerge, en biais, d’une écumeuse collerette à la mode fin XVIe siècle revue par le XVIIIe galant, Watteau en ayant éternisé les fraises autour du cou. Ce portrait respire le bonheur, dont ces yeux complices nous font témoin. C’est presque une gracieuse illustration de la culture du plaisir de vivre de ce temps que regrettait Talleyrand qui, comme elle, entre deux siècles, traversa plusieurs régimes : Monarchie, Révolution, Directoire, Empire, Restauration. Deux époques en somme, dont sa musique, du moins celle de ce disque, treize sonates pour piano solo, pourtant composée entre 1760 et 1770, témoigne : musique bien de son époque, mais avec des frémissements du futur, compositrice sensible à l’air du temps, mais attentive, et intuitive de l’avenir, d’une fraîche légèreté qui ne peut que nous évoquer Mozart, avec à l’horizon déjà romantique, une ombre de Beethoven, puisqu’on ne compare jamais, rétrospectivement, qu’avec des références accessibles, avec une écoute en surplomb historique contemporain de cette musique du passé.
À preuve, le Cantabile, premier mouvement de la Sonate N°6 en ré mineur, (D minor dans cette regrettable mode de la nomenclature musicale anglo-saxonne pour cette musique française au langage et bagage venus d’Italie). C’est la première du deuxième Cd, qui s’amorce, comme d’autres, par des ornements, trilles, appoggiatures (notes d’appui) du motif, de brefs festons festifs, de légers rubans joyeux, des aigus aériens à la main droite, démentis soudain par la main gauche qui se met à scander dans le grave une sorte de glas funèbre, qui se résoudra en notes obstinées obsessionnelles, teintées de mélancolie (CD II, plage 1).
L’on rend grâce à Nicolas Horvath, qui joue sur un piano moderne, de ne pas forcer le trait rétrospectif beethovénien en gardant une touche d’une légèreté digne du pianoforte originel que la compositrice, férue de modernité, délaissant le clavecin dépassé, avait fait venir d’Angleterre. Il fait ressortir tout le côté capricant parfois de cette musique malicieuse, fantaisiste, virtuose, pleine d’effets, de surprises rythmiques et harmoniques. On ne doit pas oublier qu’elle était destinée à un salon, assurément connaisseur auquel la maîtresse de maison faisait la grâce de son esprit, exprimé en musique, se mettant et s’exposant en scène devant un public choisi pas forcément tendre, où se pressaient pas moins que Luigi Boccherini et son empressé très proche ami Benjamin Franklin. Mais il faut se défaire de l’anachronique idée, trop répétée et regrettée, d’un confinement musical dans le champ clos d’un salon : le salon était alors le cadre général de la musique, forcément de chambre, synonyme de salon. Le piano ne gagnera les grandes salles de concert qu’au siècle suivant bien entré, avec l’avènement es pianistes vedettes, les grandes salles étant alors destinées à la musique orchestrale et les opéras. Imaginons quel frisson de fièvre pour les invités à l’écoute de cette déjà fantastique chevauchée, cette course à l’abîme sous les doigts d’une élégante hôtesse, mouvement mouvementé que propose la plage 9 !
C’est à Nicolas Horvath, connu pour ses interprétations de musique contemporaines, de Satie à Phil Glass, que l’on doit la restauration des partitions et la résurrection de cette compositrice à laquelle il se voue et dévoue, m’avouant, une proche suite à ce double CD. Cette musique, qu’il édite aujourd’hui, était restée inédite jusqu’à lui. Mais je ne suis pas sûr que la cause en soit, comme on l’avance dans le livret, à l’inconvenance qu’il y aurait eu, pour une femme du monde à se faire publier. Je pense plutôt à l’inutilité économique, pour une femme riche, d’une telle démarche strictement commerciale, vitale pour les musiciens professionnels sans mécène, comme le pauvre Mozart venu à Paris avec sa mère, dans l’espoir de faire imprimer, à bon marché, des sonates sur le moule de celles d’un compositeur rival qui avaient du succès à Mannheim, rêvant de les vendre pour survivre. Sans compter la mondaine Élisabeth Vigée Lebrun qui faisait payer des fortunes ses tableaux dans toute l’Europe, et des écrivaines prolifiques (Madame Riccoboni, Madame de Genlis, Manon Roland qui paya de sa vie son engagement, etc, et à Venise autant de femmes que d’hommes écrivains) une musicienne contemporaine, l’italo-écossaise Sophia Corri Dussek (1775-1845), célèbre comme chanteuse (accompagnée par Haydn), devenue veuve, sans emploi, doit composer pour harpe ou piano, même jusqu’en en France en 1812 pour subsister avec sa famille.
Anne-Louise Brillon a la fortune de son mari, son public, son salon où se produire, ses deux filles chanteuses Cunégonde, sûrement clin d’œil à Voltaire, et Aldégonde sans doute à la mode gothique du faux Ossian. Elle peut laisser dormir ses quelques quatre-vingt-dix œuvres dont elle n’a pas besoin pour vivre. Imputons son oubli plutôt à la culture machiste dominante, qui a sacrifié les Fanny Mendelssohn, Clara Schumann, Alma Mahler à leurs illustres frère ou époux, complices. Nous redécouvrons à peine Nadia et Lilli Boulanger, Cécile Chaminade, Henriette Renié, etc Saluons donc cette redécouverte que nous offre Nicolas Horvath. On admirera, pour finir, la fouge, jamais confuse, de l’Andante un poco allegro de la Sonate XI en ré mineur, tout fleuri de grappes d’appoggiatures, de trilles comme des battements d’ailes d’oiseaux, et semé de rafales de triolets (plage 11).
BRILLON DE JOUY, The piano sonatas rediscovered, Nicolas Horvath, piano; label Grand piano ; 2 CD. Premier enregistrement mondial
RCF : émission N°540 de Benito Pelegrín. Semaine 29